On avait beaucoup aimé Sous les figues en 2021, on en attend encore plus cette année. Eh bien c’est raté. Contaminée par le fameux syndrome "film de festival", Sehri en perd son identité par un académisme qui efface toute aspérité à son film qui, dépassé par son sujet (la répression de l’immigration subsaharienne en Tunisie), file et nous perd. Aïssa Maïga se démène mais n’incarne au final pas grand-chose, l’écriture reste sommaire, et l’émotion qui devait nous gagner s’efface et nous délaisse. Il y a là un manque d’engagement édifiant pour un second long métrage qui semble balisé par une production contrôlante. Le contraste est d’autant plus saisissant avec son précédent long-métrage, Sous les figues, qui était bien plus vivant, vivifiant, personnel, et venait nous toucher par sa générosité et sa mise en scène inventive. Tout est ici littéral, et finalement un peu ennuyant. Alors pas de bol pour le réveil à 7h30, on ne peut pas gagner à tous les coups.

Si ce n’est avec la Quinzaine des Cinéastes qui ne nous déçoit que très rarement, une sélection "penalty sans goal" représentant probablement la section la plus euphorisante. Dirigons-nous donc d’un pas assuré et sous un ciel sans nuage vers le film de Louise Hémon L’engloutie. Fascinant conte d’époque (on est en 1900) où une jeune enseignante débarque dans un petit village paumé pour éduquer ses bambins. L’ambiance semble légère, folklorique, la danse, les rires et les confrontations des générations irradient le film d’une étrange douceur (très belle scène de danse en milieu de film) malgré la rudesse du décor, une neige qui isole et coupe du monde. Un monde qui s’apprend d’ailleurs par la géographie et cette mappemonde qui intrigue ses villageois s’interrogeant sur la place de la Californie et de l’Algérie sur la carte. Puis Louise Hémon vient tromper son audience, et de cette apparente légèreté naît le désenchantement, de ce visage grêle et rassurant de l’excellente Galatea Bellugi (que l’on avait adorée dans Chien de la casse) une ambiance mortifère, ses costumes s’assombrissent et dessinent avec vigueur les contours d’une veuve noire intraitable. On ne sait jamais réellement où l’on va ni pourquoi, mais on plonge volontiers dans cette neige épaisse et mystérieuse, ce blanc en contraste du noir, de l’apparition à la disparition, l’ombre du Malin est proche et féminine. En somme, un premier long métrage sacrément bien fagoté, mais un peu chancelant, bourré d’idées, mais peut-être au cœur encore un peu trop tendre. Il me faut dormir, là, tout de suite. Bon, très bien, après cet immonde kebab falafel sec comme du bois. Et cette crêpe au chocolat hypercholesterolémiant qui va achever de boucher mes artères. Mais là, il me faut fermer les yeux. Car la suite s’annonce coriace, avec l’enchaînement de deux films en compétition officielle.
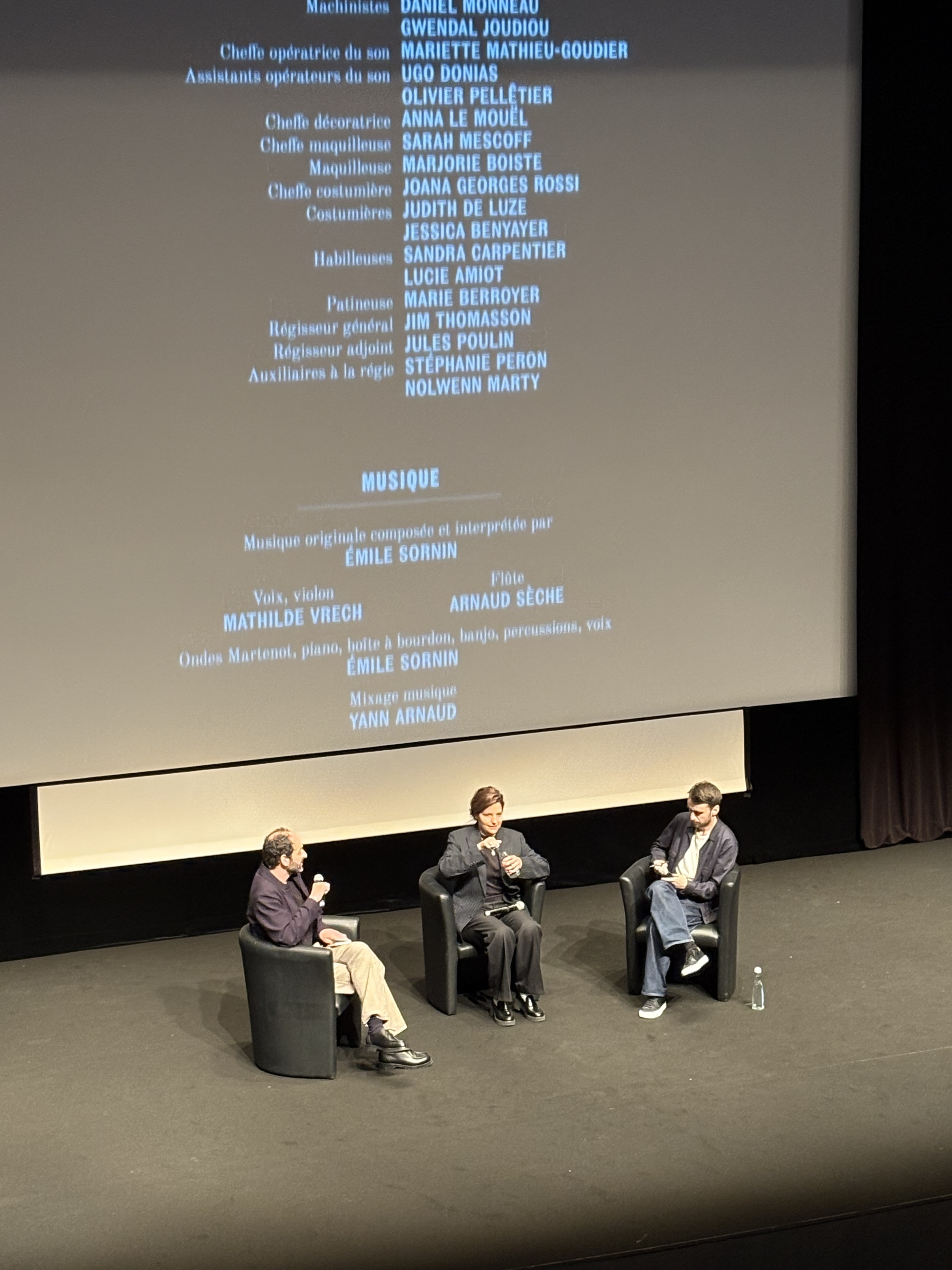
Réveil abrupt, j’aurais pu faire ma nuit. À peine le temps d’effacer mon élégant filet de bave post-sieste que je me dirige vers la salle Debussy pour découvrir le nouveau film de Dominik Moll (qui avait cartonné il y a deux ans avec La nuit du 12) Dossier 137, le type ne peut s’empêcher de chiffrer ses titres à priori. Moll s’attaque au fait divers du 8 décembre 2018, lorsqu’un gilet jaune s’est fait tirer dessus à bout portant et en plein visage par un agent de la BRI, à deux pas de l’Arc du Triomphe, le laissant agonisant dans une mare de sang. Le film suit l’enquête de l’IGPN (Léa Drucker à sa tête) pour reconstituer la vérité du récit de cette tragique fin de soirée. Et le problème majeur du film est déjà dans son pitch. Car Dominik Moll multiplie les points de vue (IGPN, flics agresseurs, famille de l’agressé, civils et témoins) mais fait taire de manière tragique et incompréhensible la seule voix qui compte, celle de la victime. Cette victime qui a certes le droit à l’ultime minute du film, mais l’enjeu, le réel enjeu est dissout, absent. Encore une fois, la police ne cesse de jacter pendant que la victime est inaudible, muette, elle est noyée sous ce torrent d’excuses et de pénibilité. On n'en peut plus de ces excuses, de ces répétitions sur la dureté de ce terrible métier pourtant choisi consciemment. Nous voulons écouter ceux qui souffrent, ceux qui, par la faute d’un agent représentatif du droit républicain, ont vu leur vie anéantie. Je voulais l’écouter, lui et personne d’autre, apprendre de sa vie, de son courage, et de sa reconstruction après un tel événement traumatique. Il n’en sera rien, Dominik Moll préférant se larmoyer sur cette enquêtrice de l’IGPN, elle qui finira par être méprisée de tous, des flics, des civils, des agresseurs et des agressés, jusqu’à son propre fils qui lui tournera le dos. Mais ce sujet est vain et absent. Alors dans cette enquête pas si mal ficelée par une mise en scène, j’en conviens, impeccable, qu’en sortir ? Pas grand-chose, ou si, ce visage à la toute fin, celui de cette victime qui ne baisse pas les yeux et apprend à pardonner. Pendant que les autres se confondent dans l’excuse et le mensonge en pure lâcheté.

Je sors, je re-rentre, un moulin que cette salle Debussy. La gorge me gratte, je suis en totale déshydratation. Mais je souffre en silence et avale ma salive pour compenser ma bouteille d’eau inexorablement vide. Ça jacte en allemand dans tous les sens. Normal, voilà que débarque Fatih Akin et son dernier film Amrum avec Diane Kruger. En toute franchise, pas un grand fan du réalisateur allemand, mais tentons le coup. Et voilà une belle surprise ! Akin s’attaque à un pan d’histoire communément délaissé du cinéma, la reconstruction identitaire post-capitulation allemande, et dans Amrum, elle se fait à travers les yeux du jeune Nanning, tiraillé entre une mère nazie et un environnement proche des alliés. Ça dégouline un peu avec un message très convenu et une quête de fraternité et de réunification un peu trop grosse pour être vraie. Le film est également limité par sa coquille de cire et son environnement pacifié par une photographie archi léchée, un peu auto-glorifiant pour son metteur en scène, du genre « regardez comme je filme bien ». Néanmoins, ne crachons pas dans la bonne soupe allemande, il y a du cœur là-dedans, une question viscérale qui a secoué et continue de secouer toute une nation. Akin fournit donc quelques pistes à cette reconstruction, comme cette entraide entre le jeune garçon allemand et des immigrés polonais, ou cette très belle ultime séquence, touchante, avec cet échange entre Nanning et une jeune fille, l’affrontement du passé sans reniement, en pleine conscience, l’acceptation totale pour un futur douloureux mais enfin ouvert au monde. Ça ne restera pas dans les annales, mais ça se défend.

Je ressors, je re-re-rentre, promis, c’est la der’ de la soirée, ma peau commençant dangereusement à se greffer au siège de la salle Debussy. Allez, on attaque le second film en compétition officielle de la journée, Sirat de Oliver Laxe. Et quel film mes amis ! premier réel choc de cette sélection 2025. Dans cette danse apocalyptique d’une rave en plein désert marocain, la fin du monde gronde, la Troisième Guerre mondiale est annoncée à la radio, et les réverbérations des enceintes absorbent sa conscientisation. Sirat est un film parfaitement conscient d’un monde en auto-destruction, plus rien n’a de sens ni d’importance, pas même le ridicule (et un jeu d’acteurs à la limite du grotesque), le vent souffle le vide, une force désincarnée s’en détache, un monde mort-vivant qui n’a plus que son propre rythme pour mourir et s’éteindre. Le film est d’une pureté radicale, totale, la mort est accompagnatrice d’une disparition programmée, l’enjeu initial (un père et son fils cherchant leur fille/sœur) annihilé très rapidement par une succession de souffrance, de radicalité, d’un désarroi si générationnel et cette acceptation d’une fin du monde que l’on sait imminente. Premier vrai coup de cœur, mais avec une présidence sous Binoche, on voit mal comment ça pourrait passer au palmarès. Bon allez, cinq films en une journée, ça a un peu vrillé aujourd’hui, mais il faut savoir charger la mule en début de festival tant que l’énergie y est encore. En revanche pour la teuf, on abandonne Charli XCX à la plage Magnum et Chrysta Bell au Silencio pour un vrai dodo réparateur. Promis, demain, on s’y met.
